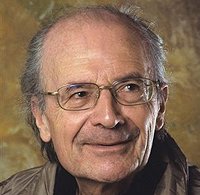C’est un chemin singulier mais lumineux que nous invite à parcourir avec lui, le temps d’une rencontre, ce poète montpelliérain…
Parcouru depuis son enfance par la nécessité du poème, le voyant émerger dans sa vie au cours de son séjour au Maroc, Bernard Jakobiak a continué pendant de nombreuses années à se poser la question du sens de sa poésie ; comme si celle-ci s’offrait à se découvrir comme le propre mystère de sa vie.
D’étape en étape, le poète va finir par identifier cet « appelant », et en faire son chemin. Chemin sans doute sinueux, questionnant, mais aussi et surtout générateur de lumière, au double sens du mot. En venant la découvrir, vous comprendrez qu’on puisse y vouer sa vie.
Au travers de nombreux recueils publiés, la parole écrite de Bernard Jakobiak se déploie dans un langage d’une grande simplicité, vitre totalement transparente où, même à travers la révolte des premières années, transparaît une lumière éblouissante, pulsée par un charisme (qui en grec signifie « grâce ») très puissant, et dont le poète sort transfiguré.
Voici l’annonce que fait lui-même Bernard Jakobiak de cette quête et de cette découverte :
« Le chemin vers la lumière, c’est à quoi tend le poème quand il existe.
Et réaliser que le poème existe est une illumination.
Cette réalité n’a plus besoin de se mettre au service d’un projet prométhéen car ce n’est pas Dieu qui est mort mais bien Prométhée dans les villes bombardées jusqu’à Hiroshima, dans les camps de travail ou d’extermination et dans les goulags.
Les ténèbres sont partout et les interdits ont seulement changé de sens.
Le prophète Albert Camus dans « La Chute » dont on parle peu quand on pense au panthéon, avait pourtant dévoilé l’interdit le plus enfoui, l’interdit majeur, l’obscénité la plus universellement condamnée, le mot proscrit au-delà de toute limite, quand il fait s’exclamer à un des ses personnages « Mon Dieu ! » et que tous les assistants du cabaret branché s’enfuient effarés.
La révélation du poème — il existe ! — m’est venue du « Voyage » de Baudelaire, que j’avais lu bien sûr mais sans l’entendre. La quête du poème permet dès lors de résister jusqu’à la révélation de la lumière la plus intime, la plus personnelle. Le poème permet peu à peu le regard sur l’enfoui, l’enfermé, l’enterré. Peu à peu, car les résistances sont multiples et le plus souvent sans nom.
L’écoute aussi est rare. Et il est tellement facile et confortable d’étiqueter l’autre.
Avoir la possibilité de parcourir, de poème en poème, des années de recherche et de témoignages inattendus est la rare joie d’une communion possible entre le singulier le plus intime et tout l’humain en son devenir aux multiples facettes. Nul ne serait plus exclu. Et les myriades d’étoiles des galaxies pourraient bien être la pâle image de la diversité des visages et des vrais prénoms qui germent.
Ce « chemin » peut commencer par la révolte quand elle est nécessaire : ce sera « Fulgurante ascèse » puis « Argent » pour survivre en caserne, prison, idéologie ou maladie de toute sorte.
Le poème permet-il à l’homme d’être l’orpailleur du torrent tumultueux de ses voyages ou de ses fuites ?
Où est le fondement de la soif que révèle un poème ?
Pourquoi cette exigence parfaitement inutile et qui persiste ?
Quelle est la valeur de ce parcours en poèmes, vers la guérison jugée impossible d’une cécité annoncée ?
D’où est venue l’inadaptation constante, et souvent agaçante pour les proches, à tous les prosaïsmes sentis comme autant de résignation ?
Quand le poème témoigne, donne-t-il une émotion, un horizon, un peu plus de regard et d’écoute, une palpitation de l’indicible enfoui ?
Le choix des poèmes lus sera fait dans le sens de ces questions. »
— Bernard Jakobiak